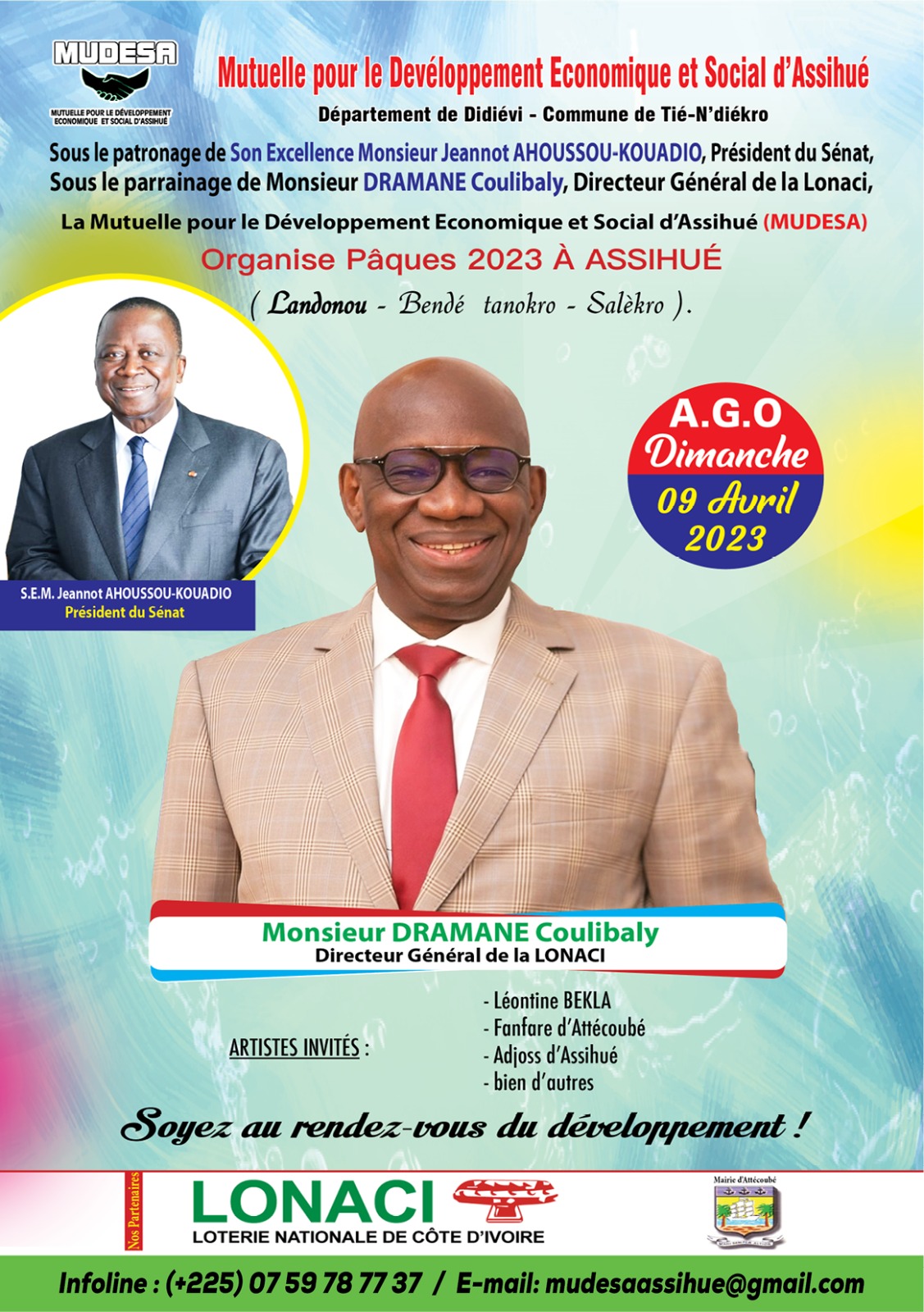Côte d’Ivoire / Arts visuels : La galerie Houkami Guyzagn immortalise Mathilde Moreau
La galerie Houkami Guyzagn d’Abidjan-Cocody-Riviera a immortalisé Mathilde Moreau, artiste-plasticienne, actuelle directrice de l’Ecole nationale des Beaux-Arts d’Abidjan ce week-end. Et ce, à la faveur du baptême officiel de sa salle d’exposition premium estampillé du nom de la première femme plasticienne de Côte d’Ivoire. En effet , ce haut-lieu de la pratique artistique en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’ouest, notamment au profit des artistes en devenir, Thierry Dia, promoteur de l’agence-galerie, entendait, à la fois, sacrifier à un devoir de reconnaissance et marquer pour l’éternité l’apport indéniable de celle qui fut, à un moment de sa riche carrière, baptisée « Prêtresse du Vohou », à l’encadrement et au rayonnement des jeunes plasticiens ivoiriens, plus de trois décennies durant. Mieux, plutôt que de laisser grisée par un succès qui aurait pu l’inscrire dans une posture d’intouchable, la prof et artiste, est devenue la marraine de ses étudiants qu’elle aide à se perfectionner en Europe, en Asie, et partout où son talent, son entregent et son carnet d’adresses peut lui permettre d’ouvrir le monde à ses pupilles ! Car, l’actuelle directrice et ce depuis une décennie, du moule dans lequel elle a été forgée, l’Ecole des Beaux-arts d’Abidjan, Mathilde Moreau a fortement contribué à l’affirmation des arts plastiques ivoiriens et africains, aux côtés de ses amis du mouvement fort matiériste, Vohou-Vohou. Tiré de la langue Gouro, le mot « Vohou-Vohou » signifie : « n’importe quoi ». Il est donné au début des années 70 aux « artistes poubellistes » de l’Ecole d’Abidjan, par dérision, par un de leurs amis architecte d’intérieur. De fait, ils montrent que la vérité picturale n’est pas qu’occidentale et académique. Portés par leur âme et leur sensibilité nègres, ces étudiants revisitent alors, par le biais de matériaux et pigments décapants pris dans leur environnement, l’espace et le support pictural. En agissant de la sorte, ils font prendre à la peinture ivoirienne un virage de 180 degrés. Pour capter dans toute sa plénitude, le parcours de Mathilde Moreau, il faut savoir avec le critique et journaliste Henri Nkoumo, « qu’à partir de 1981, Youssouf Bath, Théodore Koudougnon, N’Guessan Kra, Yacouba Touré dit Yack, anciens étudiants de l’Ecole des Beaux–Arts d’Abidjan, que rejoindra en 1987 leur cadette Mathilde Moreau et quelques autres, systématisent cette philosophie esthétique. L’exploitation, sur les cimaises, dans les salles d’exposition huppées de la place, de menus objets : tapa, cauris, jus de cola, latérite, kaolin, etc., apparaît comme une immense provocation aux yeux des réactionnaires. En même temps, elle dit, de manière forte, leur quête identitaire ontologique : être des peintres africains et des Africains peintres, et non plus des ersatz de peintres occidentaux. Comme l’aurait écrit Senghor, ils sont bien dans leur peau de lamantins allant boire à la source ». Depuis sa première exposition individuelle intitulée « Varig » (1987) (du nom d’une compagnie aérienne dont un avion s’est écrasé à Alépé), Mathilde Moreau est demeurée sur les cimaises. Ici comme ailleurs, à l’instar de la Chine où elle vécut, entre deux séjours de plusieurs années, pour y être reconnue comme un as de la calligraphie sui generis de l’Empire du milieu. Régulièrement, « l’ex-Prêtresse Vohou », passée aussi par l’esthétique et la philosophie du Daro-Daro, va à la rencontre du public, à l’occasion d’expositions individuelles ou collectives de tout genre, aux rencontres nationales et internationales. A force de travail, elle est, aujourd’hui, le plus grand peintre féminin de Côte d’Ivoire et un des grands noms de la peinture ivoirienne.
F. T.