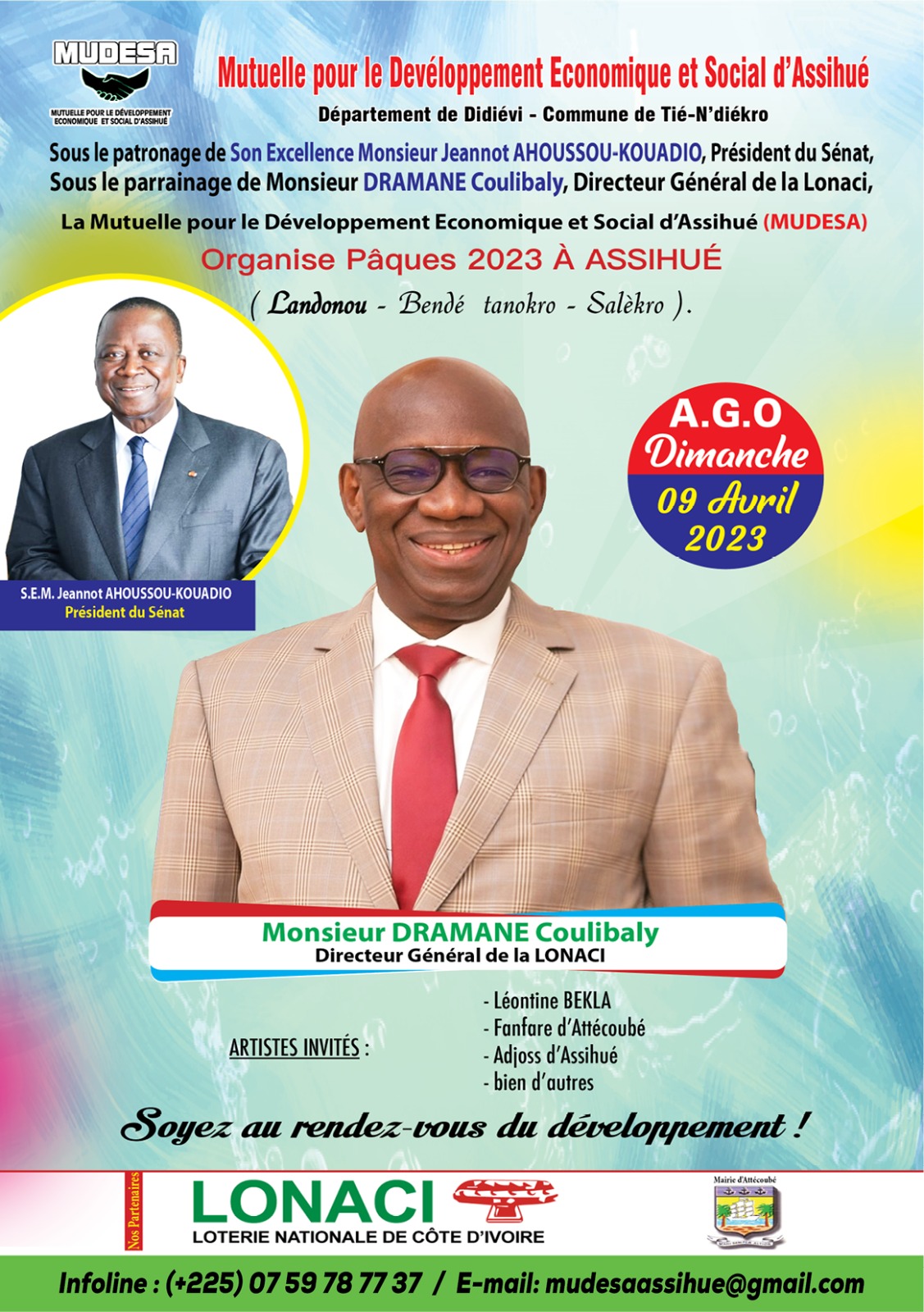Serguei Lavrov « Nous soutiendrons le Mali de toutes les manières possibles »
Au terme de sa visite au Mali, Serguei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a animé une conférence de presse conjointe avec Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, Bamako, 7 février 2023. Le chef de la diplomatie russe réaffirme le soutien de son pays aux pays en proie au terrorisme. Ci-dessous, son discours et les échanges.
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes très satisfaits des pourparlers de fond et confidents. Ils ont commencé par une réunion au ministère des Affaires étrangères du Mali et se poursuivront après la conférence de presse, notamment par une réception du président malien de transition du pays, Assimi Goïta.
Il s'agit de la première visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie en République du Mali. Il a une signification historique. Mais aujourd'hui, plus que les symboles, ce sont les actions concrètes qui sont importantes pour assurer la justice dans les affaires internationales, et le respect des principes clés de la Charte de l'Organisation. Sur ce point, le Mali et moi-même sommes pleinement alignés, y compris dans le cadre du Groupe des amis pour la défense de la Charte des Nations unies, récemment créé à New York.
Depuis la décolonisation, notre position commune est fondée sur des décennies d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. Nos amis du Mali connaissent bien ces pages glorieuses de notre histoire. Nous voulons une base solide pour nous permettre de construire de nouveaux projets mutuellement bénéfiques et prometteurs. C'est exactement ce vers quoi nos présidents nous ont orientés. Ils se sont parlé au téléphone plusieurs fois à la fin de l'année dernière. Ils ont fixé des objectifs dans tous les domaines de notre coopération : commerce et économie, investissements, domaine militaro-technique, action humanitaire et politique étrangère, qui est une priorité pour les deux ministères.
Comme l'a dit M. le Ministre, le président de transition du Mali, M. Assimi Goïta, a décidé de participer personnellement au deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg à la fin du mois de juillet. Nous serons heureux de voir M. le Président et M. le Ministre lors de cet événement important.
Nous sommes convenus de poursuivre nos efforts pour élargir les possibilités dans le domaine commercial, économique et des investissements. Le chiffre d'affaires commercial augmente assez rapidement (plus de 20% l'année dernière), mais les chiffres absolus ne sont pas très impressionnants. Il s'agit d'une évaluation générale. Nous sommes convenus que les domaines prometteurs pour nos efforts étaient le développement des réserves minérales, l'exploration géologique, l'énergie, les transports et autres infrastructures, et l'agriculture. Nous demanderons instamment aux milieux d'affaires de nos pays d'intensifier leur travail sur toutes ces possibilités, notamment en accordant une attention particulière à la préparation adéquate du forum économique, qui se tiendra à la veille du sommet Russie-Afrique.
Nous poursuivons l'aide humanitaire au Mali, principalement par le biais de canaux bilatéraux. J'espère que les livraisons de blé, d'engrais, de produits pétroliers et d'autres biens stratégiques commenceront dans un avenir très proche. En plus de nos démarches bilatérales dans ce domaine, nous fournissons régulièrement une aide humanitaire sous forme de denrées alimentaires par l'intermédiaire du Programme alimentaire mondial des Nations unies.
Nous avons une longue histoire de coopération dans le domaine de l'éducation. Quelque 10.000 Maliens ont été diplômés dans notre pays. Cette coopération se poursuit. À partir de l'année académique 2023-2024, nous augmenterons considérablement le nombre de bourses gouvernementales pour les citoyens maliens – de 35 à 290.
Nous sommes reconnaissants à nos collègues pour les informations détaillées sur la situation au Mali, sur les efforts des dirigeants du pays pour stabiliser la situation, mettre en œuvre de bonne foi l'accord de paix d'Alger de 2015 par tous ses signataires et préparer d'autres mesures destinées à promouvoir les objectifs de transition. Nous partageons l'avis que le principal défi pour les Maliens à ce stade reste la sécurité. La résolution de ces problèmes devrait fournir une base solide pour la poursuite de l'action, y compris l'organisation prévue d'élections.
Nous soutiendrons le Mali de toutes les manières possibles dans la mise en œuvre des objectifs fixés, et nous le ferons lorsque les sujets pertinents seront abordés par le Conseil de sécurité des Nations unies. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation opère au Mali. Son mandat est revu périodiquement par le Conseil de sécurité. Cela doit se faire uniquement en tenant pleinement compte des souhaits exprimés par le pays hôte de la Mission, le Mali.
Nous continuerons à apporter le soutien bilatéral nécessaire à nos amis, non seulement en matière de développement économique, commercial et social, mais aussi pour améliorer l'efficacité au combat des forces armées maliennes et former les troupes et le personnel chargé de faire respecter la loi. Nos amis maliens ont des demandes spécifiques à cet égard. Ces objectifs sont systématiquement atteints. En 2022-2023, la coopération dans le domaine militaire et militaro-technique a été renforcée par l'envoi d'un important lot de matériel aéronautique russe. Grâce à cela, l'armée nationale du Mali a récemment pu mener des opérations réussies contre les terroristes, qui restent pour l'instant actifs sur le territoire du pays. Le deuxième chargement de matériel aéronautique à ces fins a été expédié le 19 janvier dernier.
La lutte contre le terrorisme concerne également d'autres pays de la région. Nous les aiderons à surmonter leurs difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso, le Tchad, la région du Sahara et du Sahel en général et les pays côtiers du Golfe de Guinée.
Tout en communiquant avec nos amis et en faisant des plans pour l'avenir conformément aux accords des présidents, nous avons souligné que nous voyions la réaction négative des pays occidentaux à ces processus dans les relations russo-maliennes. Nous constatons avec regret qu'il s'agit d'une nouvelle manifestation de l'attitude négative de l'Occident à l'égard des principes d'égalité et de respect mutuel dans les affaires internationales, de l'égalité souveraine de tous les États prévue par la Charte des Nations unies, ainsi que des approches néocoloniales et de la politique de deux poids, deux mesures de la part des anciennes métropoles.
L'Occident promeut le concept d'un "ordre mondial fondé sur des règles". Ces "règles" n'ont jamais été présentées à quiconque, nulle part. Cela a permis à nos collègues occidentaux de manipuler l'opinion publique dans leurs propres pays et dans les États d'autres continents pendant des années. L'obsession par leur propre exclusivité, leur supériorité, leur impunité était évidente dans la politique occidentale de ces dernières années dans presque toutes les parties du monde. En Europe, c'est la mise à mal de tous les accords politiques sur lesquels reposait l'architecture de sécurité européenne. L'Occident a refusé de la fixer sur une base juridiquement contraignante. Le résultat a été la poussée effrénée de l'Otan vers l'est, préparant l'Ukraine à servir d'avant-poste à une guerre hybride contre la Fédération de Russie.
L'Alliance de l'Atlantique Nord a déclaré qu'elle serait chargée de la sécurité dans la région Asie-Pacifique. Des exercices militaires réguliers des pays de l'Otan y ont déjà commencé, sans aucun rapport avec l'océan Indien. Il a été annoncé que le but de tous ces exercices était de contenir la République populaire de Chine. On peut trouver dans n'importe quelle région des exemples d'actions de l'Occident collectif se ralliant sous l'égide des États-Unis pour promouvoir son exceptionnalisme. En termes simples, c'est qu'ils veulent contrôler le destin de tous les peuples du monde.
Comme je l'ai dit en citant l’exemple du Mali, nous assistons à une récurrence de la mentalité coloniale sur le continent africain, à des tentatives de construire des relations "à l'ancienne", celles du "maître" et de l'"esclave". Avec nos amis du Mali et la grande majorité d'autres pays africains, nous pensons que les anciennes métropoles devraient oublier comment elles ont conquis et exploité le territoire et le continent. Elles devraient s'habituer au fait que le monde a changé. La Déclaration de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux n'était pas une imitation de la diplomatie (comme il est désormais de bon ton en Occident d'appeler certains arrangements), mais un document approuvé à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. En tant que telle, la Déclaration est contraignante. Les anciennes métropoles devraient respecter les décisions adoptées sur une base universelle et connaître leur place dans le format actuel de développement des relations internationales.
Nous avons discuté de notre coopération aux Nations unies, où nous agissons à partir de positions presque identiques. Nous sommes reconnaissants à nos amis maliens pour leur soutien aux initiatives russes sur les nombreuses questions à l'ordre du jour de l'Organisation mondiale, qui deviennent de plus en plus pertinentes: l'inadmissibilité de la glorification du nazisme et du début d'une course aux armements dans l'espace; la nécessité de renoncer au déploiement d'armes dans l'espace; la tâche consistant à élaborer des mesures de confiance et de transparence dans l'environnement spatial; et de nombreuses autres initiatives promues par la Russie, notamment dans le domaine de la maîtrise des armements et de la non-prolifération des armes de destruction massive.
Nous pouvons voir que nos amis maliens font preuve d’une approche de principe face aux tentatives provocatrices de lancer des résolutions antirusses sans raison. Le régime de Kiev et ses manipulateurs occidentaux qui lui ont mis le pied à l'étrier sont derrière tout cela. Elles n'ont rien à voir avec la volonté de résoudre les problèmes qui se posent dans la pratique. Elles ne signifient qu'une volonté de politiser et d'idéologiser constamment la situation et, par le biais d'accusations hystériques à notre encontre, de justifier leurs propres nombreux crimes: militaires, contre les minorités ethniques et bien d'autres commis par les dirigeants de Kiev depuis le coup d'État sanglant de février 2014.
Nous continuons à promouvoir la résolution des problèmes relatifs au continent africain. Nous avons toujours soutenu que les problèmes devraient y être résolus sur la base du principe "des solutions africaines aux problèmes africains", de sorte que les pays du continent se mettent d'accord sur la manière d'aller de l'avant et qu'aucun des acteurs extérieurs (en particulier ceux des anciennes métropoles) ne tente d'imposer telle ou telle solution, en utilisant les méthodes les moins scrupuleuses de pression personnelle et autre. Nous sommes favorables à ce que les Africains aient la possibilité de négocier entre eux. La communauté internationale doit soutenir leurs efforts sur le plan moral, politique, juridique par l'intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations unies et sur le plan matériel, en renforçant leurs capacités de défense et leur aptitude à mettre en place des structures de coopération régionale ouvertes au monde extérieur et aux pays désireux de faire des affaires avec les États africains sur la base de l'égalité, du respect mutuel et des avantages réciproques.
C'est ainsi que nous travaillons avec nos partenaires maliens. J'invite M. le Ministre à poursuivre notre communication et à se rendre en Russie à un moment opportun. Quoi qu'il en soit, nous devrons préparer le sommet Russie-Afrique. Je me réjouis de le voir bientôt.
Question (traduction du français): J'aimerais connaître les perspectives de coopération bilatérale militaire et militaro-technique dans le domaine de la sécurité. Vous avez dit que les Maliens étaient préoccupés par cette question. Beaucoup a été fait dans ce domaine. Mais nous sommes conscients de tout ce qui reste à faire pour assurer la sécurité de notre pays. Nous savons que les Maliens comptent sur la Russie. Malgré tous les efforts, le mal n'a pas encore été complètement éradiqué. Que comptez-vous faire d'autre pour l'éradiquer complètement, conformément aux objectifs que s'est fixés le gouvernement malien? Que peut-on faire de plus en termes de coopération?
Serguei Lavrov: En ce qui concerne notre coopération militaire et militaro-technique, nous avons abordé ce sujet en détail dans nos déclarations introductives. Au cours des derniers mois, nous avons effectué d'importantes livraisons de matériel aéronautique, ce qui a considérablement amélioré la capacité et l'aptitude des forces armées et de sécurité du Mali à éradiquer la menace terroriste. En termes d'équipement aéronautique, les forces armées et l'armée de l'air de la République du Mali sont parmi les mieux entraînées et les plus efficaces de la région. Il en va de même pour l'entraînement des troupes. La fourniture d'équipements et la formation "vont de pair". Nous prévoyons des mesures supplémentaires dans le domaine de l'éducation par le biais d'établissements militaires d'enseignement supérieur et dans celui de la fourniture d'armes et d'équipements militaires.
Pour répondre à votre question spécifique sur ce que nous allons faire d'autre, nous n'allons pas entrer dans les détails maintenant. Ce ne sont pas des informations publiques. Il s'agit d'accords qui sont conclus par décision des présidents entre les départements militaires.
Question: Peut-on dire, à l'exemple du Mali, qui a renoncé aux services de défense de la France et développe des relations qualitativement nouvelles avec la Russie, que Paris a perdu son statut de partenaire privilégié des pays africains et que, d'une manière générale, la politique colonialiste que l'Occident pratique à l'égard des États sans défense s'est effondrée?
Serguei Lavrov: Il y avait une observation dans la question que le Mali avait refusé les services militaires de la France dans le domaine de la défense. Je n'ai pas eu cette impression. Lorsque M. Diop et moi-même avons échangé des vues à New York en septembre 2021, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le Mali était l'un des sujets les plus brûlants de l'époque. Le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, et le Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, m'ont rencontré. Ils me disaient qu'ils avaient entendu dire que la Russie allait développer une coopération militaire au Mali. Ils ont dit que ce serait mal. Seule l'Union européenne devrait faire ce qui est nécessaire en Afrique.
Mon ami, M. Diop, peut me corriger, mais à l'époque, la position du Mali, son désir de trouver des partenaires de sécurité supplémentaires était motivé par le fait que la France elle-même avait annoncé qu'elle mettait un terme à ses projets militaires au Mali, y compris trois bases militaires dans le nord et son contingent Barkhane. Par la suite, le contingent de l'Union européenne a retiré sa présence.
Les anciens partenaires de la République du Mali se retirant et "mettant à nu" la capacité du pays et de sa population à assurer leur sécurité, Bamako s'est tourné vers la Fédération de Russie. La Russie a répondu à l'appel légitime du gouvernement légitime, et M. Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, l'a longuement expliqué à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies.
J'ai déjà commenté ce que nous entendons maintenant de Paris et d'autres capitales concernant notre coopération avec les pays africains. Ce sont des instincts néocoloniaux qui refusent de mourir et qui empêchent manifestement nos collègues occidentaux de reconnaître la réalité du monde moderne, la nécessité d'être plus modestes (c'est un euphémisme), d'occuper la place dans l'ordre mondial que l'histoire et leurs propres actions pour tenter de ralentir cette histoire leur ont donnée.
A propos de M. Borrell, je viens de recevoir son dernier commentaire sur notre séjour ici. Lorsque nous avons effectué notre première tournée africaine il y a quelques semaines, il a suivi nos traces en République d'Afrique du Sud, essayant par tous les moyens de saper la possibilité d'une coopération égale entre la Russie et les pays africains. Du moins, il ressortait clairement de ses déclarations que les Africains ne devaient pas faire confiance à la Fédération de Russie. Il écrit maintenant que Sergueï Lavrov est de nouveau en tournée en Afrique - au Mali. "C'est un pays facile pour eux, mais d'autres ne le sont pas autant. La Russie répand partout des mensonges sur les responsables de ce qui se passe." Cela vient d'un homme qui ne sait pas comment cacher la nature raciste de sa vision du monde. Il n'y a pas si longtemps, il n'a pas hésité à dire publiquement que l'Europe est un "jardin fleuri", il est donc un jardinier. L'Europe serait entourée d'une "jungle" d'où émanent les menaces qui pèsent sur le "jardin fleuri". Le "jardin fleuri" devrait donc faire plus attention à la "jungle" et protéger son bien-être de l’influence négative de celle-ci.
Il n'y a rien à ajouter quant à savoir par qui et comment sont traités les besoins et les intérêts des pays africains. Nous n'avons rien à cacher et nous n'avons pas à avoir honte. Nous étions à l'origine de la libération de l'Afrique du "joug colonial". L'Union soviétique a été l'un des principaux initiateurs de la Déclaration de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Il ne s'agissait pas d'une imitation, comme Boris Johnson a récemment qualifié les accords de Minsk sur l'Ukraine. La Déclaration sur la décolonisation est un véritable acte historique qui a scellé la chute de la "domination" coloniale. Il est vrai qu'il existe toujours des résolutions de l'Assemblée générale non appliquées concernant la France qui n'a pas rendu l'île de Mayotte aux Comores au mépris de ces résolutions, et les collègues britanniques qui détiennent également illégalement l'archipel des Chagos au mépris de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais la cause de la décolonisation est achevée à 99%. Il faut espérer que l'Assemblée générale fera également aboutir les autres questions en suspens. Comme nous l'avons vu aujourd'hui et ces derniers temps, la rechute des instincts coloniaux suscite une réaction qui est décourageante pour les illusions de nos partenaires occidentaux qui ne veulent pas accepter que la marche de l'histoire nous a finalement amenés à respecter les principes de la Charte des Nations unies sur le respect de l'égalité souveraine des États.
Question (traduction du français): Le Mali coopère avec la Chine et d'autres pays occidentaux. Quelle est la place de la coopération du Mali avec la Russie aujourd'hui?
Serguei Lavrov: En ce qui concerne la coopération commerciale et économique entre nos pays. La comparant aux indicateurs qui caractérisent le chiffre d'affaires commercial du Mali avec la Chine et avec les pays occidentaux, nous partons de l’idée que ces décisions appartiennent à nos partenaires maliens. Certes, nous constatons qu’à ce jour nous avons un chiffre d'affaires commercial modeste. Bien qu'il y ait de bonnes perspectives non seulement dans le commerce, mais aussi dans la promotion de projets d'investissement conjoints.
Notre part dans le chiffre d'affaires extérieur du Mali va augmenter. Nous n'avons et ne pouvons avoir aucun problème avec les décisions prises par les dirigeants maliens concernant d'autres partenaires dans la sphère économique, que ce soit la Chine ou quelqu'un d'autre. Les Maliens eux-mêmes, leurs dirigeants, les ministres en charge de ce domaine prennent des décisions en tenant compte de tous les facteurs et principalement en fonction de la garantie de leurs intérêts à long terme.
Question: Les experts de l'ONU menacent d'enquêter sur de "possibles crimes" commis par l'armée malienne et le groupe Wagner. Que pensez-vous de ces initiatives?
Serguei Lavrov: Je ne connais pas d'"experts" de l'ONU qui seraient habilités à examiner les crimes de guerre, peu importe qui les a commis.
Je sais que le Conseil de sécurité des Nations unies a de tels pouvoirs. Les mêmes dispositions ont été autrefois inscrites dans le statut de la Cour pénale internationale. Les pays adhérents doivent se conformer aux décisions de la Cour. Mais il existe des dérogations dans le contexte de la logique néocoloniale de l'exceptionnalisme. La CPI a décidé il y a plusieurs années d'examiner les faits qui donnaient une indication assez forte de crimes de guerre commis par les forces militaires américaines en Afghanistan. De nombreux témoignages, des preuves vidéo et photo ont été rassemblés. Washington a tout simplement "informé" le procureur, le personnel et les juges de la CPI que s'ils devaient se pencher sur la question de l'enquête sur les éventuels crimes de guerre commis par Washington en Afghanistan, tous ces juges et autres experts seraient immédiatement sous le coup des sanctions américaines, ce qui ne les intéressait guère car nombre d'entre eux avaient des comptes bancaires aux États-Unis, des enfants étudiant dans des universités américaines, etc.
Je ne peux pas juger les motifs qui ont finalement guidé la CPI. Elle s'est discréditée à bien des égards. Ne serait-ce que par l'exemple mentionné. À l'ONU, aucun expert ne peut dire qu'il étudie les crimes de guerre ou qu'il mène une quelconque enquête. Il existe des procédures. Les collègues occidentaux tentent par tous les moyens de les briser, de saper les pouvoirs du Conseil de sécurité des Nations unies, de manipuler l'Assemblée générale de l'ONU (il s'agit d'une violation directe et flagrante des pouvoirs de cet organe en vertu de la Charte des Nations unies) et le Secrétariat des Nations unies, ouvrant la voie à la privatisation de larges départements de celui-ci et à leur utilisation dans leurs intérêts. Nous voyons cela. Nous attirons l'attention de la direction du Secrétariat sur l'inadmissibilité de l'"observation silencieuse" de telles tentatives. Nous continuerons à le faire dans l'intérêt de la grande majorité des membres de l'organisation mondiale, afin que, même en l’occurrence, les méthodes coloniales n'en fassent pas non plus l'outil commode de quelqu'un servant à promouvoir des intérêts unilatéraux.